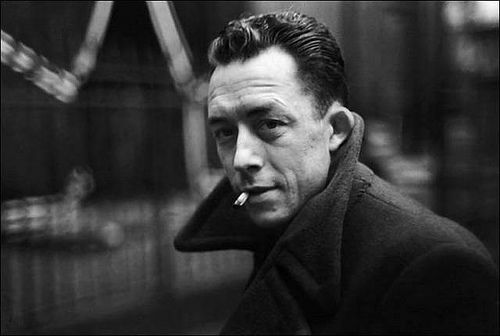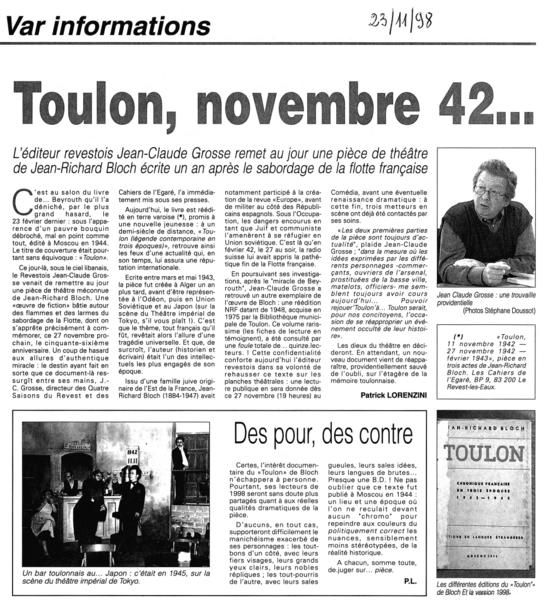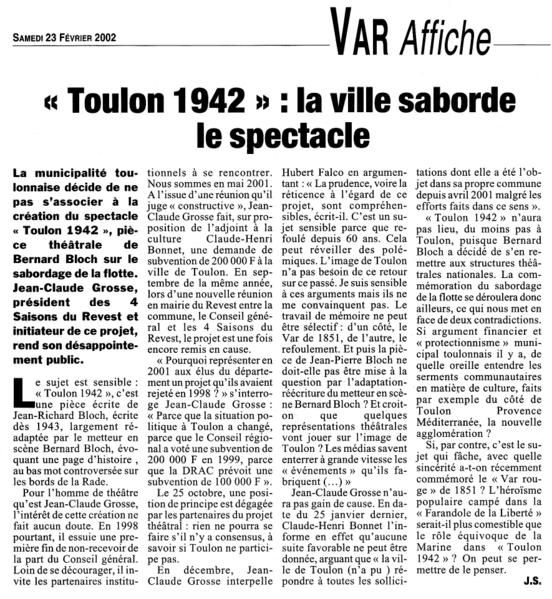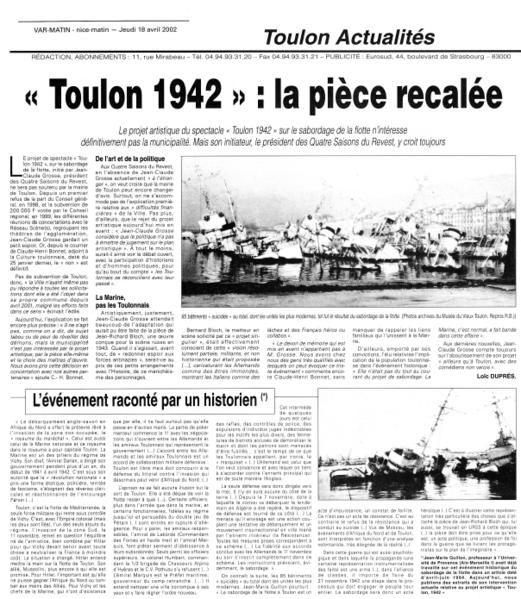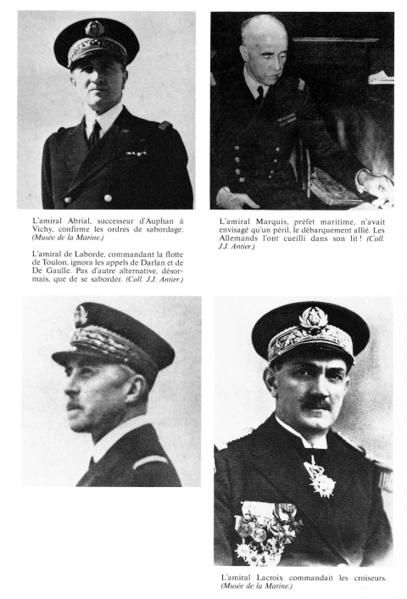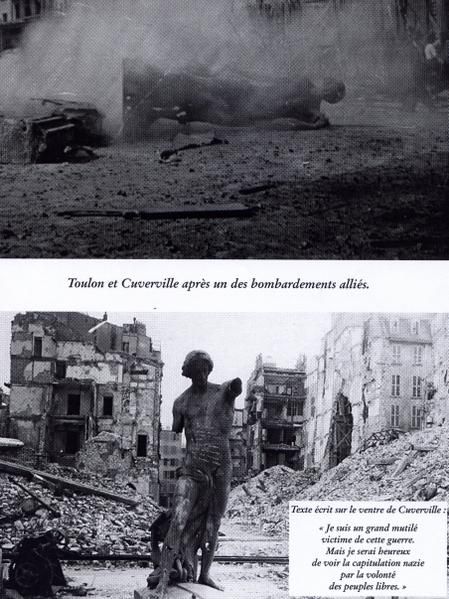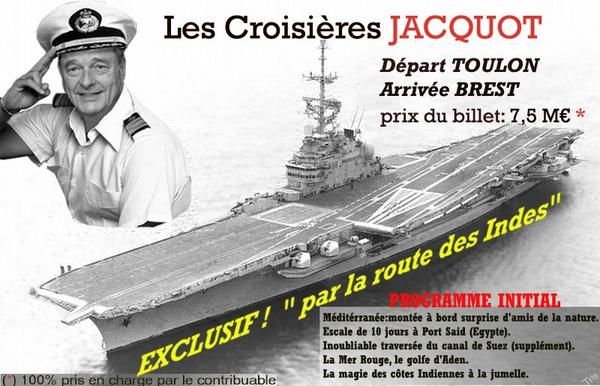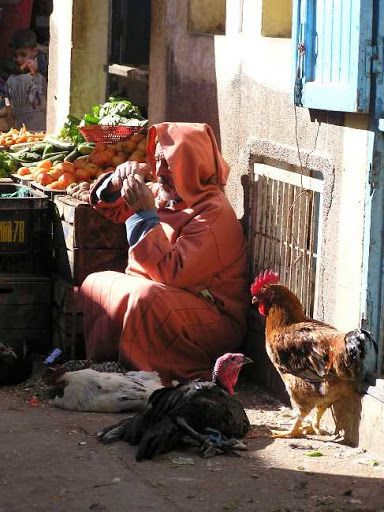Paris
du 24 avril 2008 au 6 mai 2008
j'ai toujours le même plaisir, 5 ans après
(septembre 2013)
par JCG
Cela faisait trois ans que je n’étais pas monté à Paris.
Très content de ce séjour qui m’a permis de voir et d’approcher Rosalie, Lili, Lison, une petite fille de déjà 5 semaines, au fort caractère et bien jolie dont nous avons fêté le 1° mois de vie.
Les parents me semblent s’occuper d’elle comme il faut, par paroles et gestes apaisants.
(paroles magnifiques sur Lili, dans le film: Je vais bien, ne vous en faites pas)
Lili, take another walk out of your fake world
Please put all the drugs out of your hand
You'll see that you can breath without not back up
Some much stuff you got to understand
{Refrain:}
For every step in any walk
Any town of any thaught
I'll be your guide
For every street of any scene
Any place you've never been
I'll be your guide
Lili, you know there's still a place for people like us
The same blood runs in every hand
You see it's not the wings that makes the angel
Just have to move the bats out of your head
{Au Refrain}
Lili, easy as a kiss we'll find an answer
Put all your fears back in the shade
Don't become a ghost without no colour
Cause you're the best paint life ever made
2 traductions
{LILI}
Lili, fais un tour hors de ton monde inventé
s'il te plait, enleve toutes ces drogues de ta main
tu verras que tu pouras respirer sans faire marche arrière
tu as beaucoup de choses à apprendre
pour chaque pas de chaque marche
dans chaque ville
je te guiderai
pour chaque rue de chaque lieu
chaque endroit où tu n'as jamais été
je te guiderai
Lili, tu sais, il y aura toujours une place pour des gens comme nous
le meme sang coule dans toutes les veines
tu vois, l'habit ne fais pas le moine
tu dois juste faire sortir ces voix de ta tête
pour chaque pas de chaque marche
dans chaque ville
je te guiderai
pour chaque rue de chaque lieu
chaque endroit où tu n'as jamais été
je te guiderai
Lili, aussi simplement qu'un baiser, nous trouverons une réponse
renvoie toutes tes peurs dans l'ombre
ne deviens pas un fantome sans couleur
car tu es la meilleure peinture vivante jamais faite
LILI
Lili fais un autre pas en dehors de ton monde illusoire,
S'il te plaît poses toutes ces drogues que tu as dans la main,
tu verras que tu peux respirer sans rechuter
Tant de choses que tu dois comprendre
A chaque pas dans chacune de tes marches
Dans chaque ville de chacun de tes rêves
Je serai ton guide
Sur chaque route de n'importe quel lieu
Dans tous les endroits où tu n'es jamais allée
Je serai ton guide
Lili, tu sais, qu'il reste une place pour les gens comme nous
Le même sang coule dans chaque main
Tu vois que ce ne sont pas les ailes qui font l'ange
Tu dois seulement faire sortir les démons de ta tête
A chaque pas dans chacune de tes marches
Dans chaque ville de chacun de tes rêves
Je serai ton guide
Sur chaque route de n'importe quel lieu
Dans tous les endroits où tu n'es jamais allée
Je serai ton guide
Lili, aussi simple qu'un baiser nous trouverons une réponse
Laisse toutes tes peurs dans l'ombre derrière toi
Ne deviens pas un fantôme sans couleur
Car tu es la plus belle peinture que la vie ait jamais faite
A chaque pas dans chacune de tes marches
Dans chaque ville de chacun de tes rêves
Je serai ton guide
Sur chaque route de n'importe quel lieu
Dans tous les endroits où tu n'es jamais allée
Je serai ton guide
Content de ce séjour pour les livres choisis en librairie et quelques-uns déjà lus avec notes de lecture mises en ligne.
Content pour les balades sur les quais, la présence de Jolie Môme rue Mouffetard, dimanche 4 mai, de 11 H à 13 H, content pour les gens sur les pelouses du Parc de La Villette,
au bord du canal Saint-Martin,
très colorés, content pour toutes ces filles à l’aise, pensant à Thomas Quyncet, le personnage du roman Le Peintre de Cyril Grosse, méditant sur le temps qui passe et toutes les histoires qui ne seront jamais écrites, jamais commencées mais virtuellement disponibles, possibles, comme dans l’univers quantique et sur sa vie, ratée ?, lui, le milliardaire, l'enfant choyé de sa mère, Rose O'Brien.
"Thomas Quyncet voyait dans les treize carnets de sa mère, Rose O'Brien, un triomphe de la sensibilité sur les conventions sociales, une révolution intérieure, une négation de l’esclavage quotidien, contre la mort, contre le désespoir et la fatalité, une force de vie. L’écriture comme une deuxième, une troisième, une centième vie, parallèles. Invulnérable. Vie, force de vie, rage, vivant, dédaigneux, tout ce qui, aujourd’hui, lui manquait. Dans des domaines aussi différents que la politique, la littérature, l’art, il avait cherché ce que sa mère, elle, avait trouvé sans efforts, et que ce fût sa mère le touchait d’autant plus. C’était ça, la musique était comme ça, et la danse : l’abolition de règles strictes, l’abolition de la physique, l’abolition du temps. C’était ça, une substance fabriquée par notre corps, pour notre corps. Il avait croisé dans sa vie tellement d’escrocs, de menteurs, de types mesquins, hypocrites, il avait fréquenté tellement de cercles, de milieux et aussi d’artistes – princes du partage, de la vérité et de la paix – avides de son fric, haineux, prêts à s’égorger, jaloux les uns des autres, que la générosité de sa mère et sa bonté lui faisaient l’effet d’une île perdue au milieu de l’océan, une île imaginaire, lumineuse. Depuis dix ans, il fuyait la compagnie, ne recevait que quelques intimes comme Antonina ou Hermann Salley. Les seules sorties qu’il s’accordait encore étaient celles avec Joseph. Il n’allait plus au cinéma – lui qui, dans sa jeunesse pouvait voir trois films par jour –, ni au théâtre. Il écoutait de la musique. Mais cette fuite, ce repli sur soi ne le comblaient pas plus. Aucune synthèse, un doute constant. Un balancier au mouvement perpétuel marquait son échéance.
Quai de Conti, longeant la Seine sur les pavés inégaux, hagard. Un boxeur, se disait-il, qui après l’uppercut tourne et vrille sur le ring, repart au combat, réplique coup pour coup, n’ayant comme alternative que vaincre ou finir K.O. Et Thomas essayait de vaincre. Ses yeux – rebelles, lui semblait-il, aux injonctions de son cerveau – envisageaient l’eau verte du fleuve et ses courants : une solution, un cachet d’aspirine pour sa tête, une piqûre de morphine. Se laisser couler. Plus il essayait de considérer le problème, plus son caractère aporétique lui apparaissait. Une question, une autre question, plus dangereuse que la précédente et la suivante plus vertigineuse, plus insoluble encore. Lui qui s’était habitué aux problèmes d’échec, à des heures de pénétration dans de petites pièces capitonnées, se trouvait devant un problème d’une autre dimension, sans points de fuite, sans repères chiffrés auxquels se retenir. La douce et lisse abstraction de l’échiquier, reproduite à échelle humaine, transformait ses lignes en d’effrayantes perspectives. Réalité non géométrique de la vie, chambre d’enfant. Il avait l’impression de n’avoir prise sur rien. Il avait fait un rêve, et maintenant il était son rêve dont la seule issue. Il volait, soit qu’il fût un oiseau, soit que ce fût lui, Thomas, dans le ciel. L’air se dérobait, insensiblement, et ne lui offrait plus sa résistance. Abolition de la pesanteur. Il chutait. Et à cet instant précis, ce n’était plus une image. Vaincre l’oppression de son propre cœur car, en comparaison, l’oppression des autres. Il s’arrêta sous le Pont-Neuf. À sa droite, deux clowns tiraient un orgue de barbarie, décoré de pétales de jacinthe, et se dirigeaient vers le Pont des Arts. Grimés, emperruqués, prêts à aller au boulot. Sous une bâche étaient entreposées de vieilles chaises en osier, une cage et une glacière. Un peu plus loin, sur un fauteuil recouvert d’un tissu rouge, une jeune femme les regardait partir, en fumant une cigarette. Parfois, j’imagine, parfois, je crois rêver. Vision de fin d’après-midi, au soleil. Il eut envie de s’approcher, de s’asseoir en face d’elle. Parler à une belle inconnue, se lever et repartir. Il sortit de la poche intérieure de sa veste son étui en cuir, dont il tira un double corona de Hoyo de Monterrey. Une réponse absurde, doublement absurde. Il était donc le genre de type à fumer un cigare, comme si un cigare pouvait changer la donne. Le monde sauvé par un Hoyo de Monterrey. Doublement absurde parce qu’il avait la gueule de l’emploi. Fumons un Hoyo, face à la Seine. Formule magique de publicitaire. Dictature du bonheur. Il fit tourner le double corona entre ses doigts, chauffa le pied lentement et craqua une seconde allumette. La tête s’enflamma et des volutes de fumée mauve vrillèrent et disparurent. Il avait la gueule de l’emploi et alors qu’il croyait être Thomas Quyncet, sa reine se dandinait au bout de son cigare, sur les cendres brûlantes. Thomas, simplement Thomas. Une heure auparavant, dans le café où, assis seul à une table, il dégustait un expresso, il s’était vu représenter sur un flipper. Il n’avait d’abord pas fait attention. Un adolescent jouait dans son coin ; il avait levé les yeux au hasard, il avait détaillé le titre : Love Supreme, A murder mystery – les lettres se tortillaient, flammèches irréelles – ; et il avait scruté le visage du quatrième en partant de la gauche. Un homme d’âge mûr, grand, maigre, avec une moustache et des cheveux blancs, coiffés en brosse. Voilà ce qu’il était : une gueule sur un flipper, un cliché. Le Milliardiaire en Smoking, qui vous regarde, méprisant, le bras d’une jolie fille langoureusement posé sur son épaule, un des suspects de l’enquête que mène le détective intrépide. C’était grotesque, de tous les points de vue. Manque, vie, force de vie. Une image oui, un symbole ridicule. Sous le Pont-Neuf, fumant un Hoyo de Monterrey, voilà en gros la situation. Il allait sur ses soixante ans, soixante ans l’année prochaine. Et il avait l’impression d’être déjà mort. Tout au long de son existence, il avait été obsédé par sa forme physique, gardant, malgré les excès auxquels il s’était livré, une parfaite maîtrise de son poids. Il s’était inventé – au fil des jours et des années – des règles d’hygiène personnelle, des régimes ésotériques : après une nuit d’alcool par exemple, il se tenait à jeun quelques heures, en buvant du café. Il nageait plusieurs fois par semaine, il entretenait ses muscles. C’était un des rares points d’équilibre entre lui et sa nationalité. Pourtant il sentait que sa carcasse le lâchait et que ce repère devenait aussi flou que l’étaient ses idées. Il pouvait se considérer, à soixante ans, comme un homme encore beau, plutôt bien conservé. Mais d’une part, il savait au prix de quels efforts, de quel manque de laisser-aller, il en était ainsi, d’autre part, la sensation de l’inutilité de ses efforts et du vide de sa prestance l’empêchait d’en jouir. Approche de la mort, incertitude quotidienne, certitude qu’un jour son corps ne fonctionnerait plus, qu’il ne pourrait plus, en toute liberté, faire l’amour, et qu’il passerait un temps plus ou moins long privé de sensualité. À quoi bon alors tous ces exercices ? Obèse, la fin serait la même. De paradoxe en paradoxe, traînant les pieds. Vue de l’extérieur, même avec bienveillance et sans a priori, la vie des autres paraît simple. À chaque problème, chante le sage, sa solution. Jolie petite philosophie optimiste. Suite logique d’événements sans conséquences. Il avait changé tant de fois de costumes, distribué ses bons mots dans tant de langues que la foule, déroutée par le caméléon qui, debout, variait de minute en minute et ne suivait aucune trame précise, avait dû, depuis longtemps, quitter les lieux. Non linéarité. Plus la société prônait un retour à des valeurs universelles – et d’une certaine manière indiscutables –, plus lui apparaissait la complexité de toute chose. Une sorte d’anti-pensée, comme il existe une anti-matière. Aucune ligne, aucune synthèse, alors qu’il aurait été si doux de se concentrer en un être unique, indivisible. De pouvoir penser la matière sans anti-matière, et Dieu sans la présence du vide. Une personnalité stable, sûre d’elle, engageante, comme le personnage qu’il s’était fabriqué – l’acteur grimaçant qui sautait sur un trampoline dans son dos –, et qui, toujours avait l’air sûr de lui, dont les répliques tranchaient dans les conversations, aiguisées par quarante années d’habitude et de labeur. Sa vie. Un flash-back linéaire de films hollywoodiens, comme dans sa jeunesse The great sinner. Gregory Peck fermait les yeux, l’image se troublait, se voilait doucement ; et les formes mobiles du passé remontaient à la surface. Dans tous les films – et il en avait vu des milliers – le même procédé, et toujours cette même manière de raconter une vie. Linéarité sans à-coups, sans ruptures, suivant les rails inamovibles et parfaits du destin et de la pellicule. La vie des autres paraît toujours très simple, facile à raconter. Il avait suivi, avec un plaisir hypnotique, la vie de personnages inventés, sur la page, ou dans les faisceaux lumineux d’un projecteur de cinéma. Alors pourquoi pas la sienne ?
Quai des Grands-Augustins, des jeunes filles en robes courtes le croisaient en souriant, nonchalantes et souples, de toutes jeunes filles – étudiantes, vendeuses dans des supermarchés, actrices, quoi d’autre –, avec une joie de début d’été. Et comme si elles s’étaient données le mot, elles lui souriaient toutes, en passant. Pauvre vieux cheval avec son cigare. Ces yeux et ces mines, ces démarches ondulantes. Il s’arrêta. Son enfance, oui. The great sinner, Pandora, The barefoot comtessa, Ava Gardner, dont il ne connaissait pas, dont il ne connaîtrait jamais le parfum. Il la contemplait : comment pouvait-elle être si simple et si sophistiquée ? Comtesse aux pieds nus. Il se souvenait encore de cette scène : elle dansait en compagnie de gitans, au bord d’une route. Elle possédait l’élégance d’une riche héritière et la rage d’une enfant de la balle ; à la fin du film, elle mourait, peut-être de n’avoir pas su trouver de lien entre ces deux tensions. Les jeunes passantes lui rappelaient l’Ava Gardner de son enfance. De ce point de vue, il embrassait le Pont-Neuf, la Conciergerie, Notre-Dame déjà, les deux quais, face à face. Les volutes du premier tiers de son double corona se dispersaient dans l’air tiède, se frayaient un chemin jusqu’à se dissiper. Volutes irrégulières,, spirales, autant de formes du chaos. La cendre violacée, au terme d’une combustion régulière, se détacha de l’extrémité du cigare et finit sur les pavés. Rassasiant : une expression qu’il goûtait autant que son Hoyo. Dire d’un cigare qu’il est rassasiant, comme on le dirait d’une émotion forte, d’un grand vin, d’une femme. Rassasiante à force de senteurs et de goûts. États de la matière, changements : les reflets de l’eau sur les berges, et sur les arcs du Pont-Neuf – figures mathématiques, ellipsoïdes mouvantes et réelles – croisant les courbes de la fumée de son cigare, se fondant en elle – arabesques d’un art mental, imaginaire et aussitôt oublié –. Thomas tanguait sur ses pieds, et ces images l’enivraient comme l’enivrait son cigare, et ces jeunes femmes, allant, venant, le croisant, le renversant, lui souriant. Se laissera tomber, se laisse tomber, tombera, tomba. Images, bouts de phrases, une mélancolie d’adolescent, un désespoir de vieux. Soupir sur les partitions. Les notes se suivent, s’enchaînent jusqu’au soupir qui trouble l’harmonie. Un soupir, une courte respiration. Le soleil chauffait son front et ses tempes ; la lumière l’éblouissait. Y aller, le faire, tomber à la renverse, oublier. Multiplications de pourquoi, courbes mathématiques oui, réalité non mathématique de la vie. Il était barbouillé ; son estomac déclinait ses douleurs sur le mode dodécaphonique ; il lâcha deux pets, coup sur coup, qui le soulagèrent, puis un troisième, moins arrogant. Il jeta un coup d’œil à droite, un autre à gauche. Les jeunes filles s’éloignaient, indolentes. Avec l’âge, tout se détraque, le corps est une mauvaise affaire, un truc d’occasion, assez cher à réparer. Il n’avait pas d’appétit, ça, c’était pas nouveau, ce qui l’était, c’est que quoi qu’il mangeât, il était malade, flatulent. Barbouillé, un mot français qui dit bien ce qu’il veut dire. L’estomac toujours, et il n’arrivait pas à se retenir de péter, il n’essayait même plus, du reste. Jeune, il pétait par jeu, bruyamment, pour choquer. Aujourd’hui, son ventre n’était plus cet allié, le frère farceur de sa jeunesse, mais un traître ; pas plus tard que cette nuit, avec les entraîneuses, il l’avait lâché. Mon estomac au bord du gouffre, poème par Thomas le malchanceux. Intérieur. Extérieur. Une plongée dans les sinuosités de ses intestins l’aurait peut-être fait rire. Déréglé, comme dans son enfance, un écart de plus de cinquante ans, des gargouillements du nouveau-né aux flatulences d’un quinquagénaire finissant. Il repartit vers le Pont Saint-Michel. Une fin de journée splendide, égayant le visage de jeunes filles inconnues.
Pourquoi pas un film, alors ? Plantez vos caméras et déroulons en flash-back nos tissus précieux, sortons-les des armoires où ils croupissent, détaillons-en les motifs, et à la loupe – opaque – de vos objectifs, saisissons-en les entrelacs. Il était prêt, il avait le titre : Avant le saut. Il refusait, depuis toujours, et systématiquement, les interviews, écrites, télévisées, radiophoniques, protégeant la seule petite chose qu’il possédait, son intimité. Il avait écarté de nombreuses propositions : commenter la vie de son père, ou plus tard, disserter sur sa fortune, ses collections. Il lui était arrivé d’organiser des séances de ce genre – pour Hermann Salley, surtout –, mais il n’était jamais apparu sur un écran, et sa voix, jamais, n’avait troublé les ondes. Film de sa vie, interview par lui-même, à son usage exclusif. Intime. Qu’aurait-il eu à raconter ? Que voulait-il encore ? Extrême-onction : vos dernières volontés. Déroulement continu, écoulement fluide ou au contraire, éclat, fulgurance, une vie entière se déroulant à une vitesse inimaginable pour l’esprit humain, une dilatation psychologique du temps transformant de pauvres minutes en années. Que lui restait-il ? Sa mère bien sûr, Joseph, Marie et Élisabeth. L’amour qu’il leur portait. Même s’il ne savait pas, s’il n’avait jamais su, et, peut-être, ne saurait jamais l’exprimer autrement que par ce personnage qui jouait à sa place son propre rôle. Plus Thomas Quyncet se redressait et se déployait en un cynisme érudit, plus il vieillissait et plus son corps se déglinguait. Dire son amour pour eux, alors qu’il ne parvenait même pas à le vivre. Amour, amour, mon bel amour perdu. Love and be silent. Un don, une aptitude au bonheur, à la joie. Plénitude : être, aimer, donner. Platitudes chrétiennes, trinité occidentale : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que lui restait-il ? Deux ou trois petites choses qu’il considérait encore comme des victoires. Par exemple, de ne s’être jamais conformé aux modes d’existence de son père. Son hygiène avait atteint tous les domaines de sa vie. Il niait la profusion de ses biens et de ses possibilités par un ascétisme rigide, à la limite de l’obsession. Outre ses rapports tendus avec la nourriture – alors qu’une vingtaine de personnes travaillait dans sa cuisine, pour son plaisir –, il se crispait aussi quant aux moyens de locomotion. Il ne se servait jamais de sa voiture, et son chauffeur avait depuis longtemps pris l’habitude d’être au service de sa femme. Il prenait le taxi, parfois ; il marchait des heures durant. Il avait sillonné Paris, il avait marché dans New York, Boston et dans toutes les villes dans lesquelles il s’était arrêté. La marche comme un oubli de soi, une ivresse instantanée et instinctive. Sa pensée se contractait. Ses idées les plus désespérées côtoyaient un enthousiasme inouï. Il inspirait, il expirait, il se dilatait. Idéal, idéalisme sur lequel il tirait ensuite. Quoi d’autre ? Sa fortune, sa naissance. Hormis une somme conséquente déposée en Suisse, à l’usage de Joseph et Marie, il n’avait pas placé son argent. Il dilapidait son capital en salaires et mécénat – de méticuleux banquiers avaient usé leurs combinaisons à le faire changer d’avis, et certains y avaient perdu leur santé mentale –. C’était une équation enfantine : pas de spéculation immobilière, ni de jeux en Bourse, le calcul inversé des termes de la vie d’Henry Quyncet donnait les termes exacts de celle de Thomas Quyncet. Un pied de nez macabre au mythe de l’homme d’affaires, une négation du self-made-man. De ce point de vue particulier, Thomas se considérait comme une aberration, un contre-exemple dans son milieu, et son milieu lui rendait sa considération à l’identique. On le traitait d’original, de doux rêveur – les plus intéressés –, de malade, d’assassin – les autres –. S’ajoutait à cette donnée, une seconde, de notoriété publique, plus grave, que l’on appelait l’affaire de l’aile sud. Thomas ne croyait pas à la charité chrétienne – il ne croyait pas, tout court –, ni aux dons – une méthode, selon lui barbare, qui signifiait qu’une personne donne à d’autres personnes, de l’argent ou des biens, à répartir entre d’autres personnes, la chaîne permettant aux premiers de ne pas voir les derniers, et aux seconds de récupérer une partie de la somme de l’opération –. Ainsi, il avait cédé l’aile sud de son hôtel particulier à des clochards de passage. Peu à peu, le bruit s’était répandu, et l’aile était devenue un repaire de tout ce que la ville comptait de zonards, de chômeurs, de types qui ne savaient pas où dormir. Les règles de l’aile gauche étaient simples ; il n’y en avait pas. On débarquait quand on voulait, on cassait tout, on repartait. À heures fixes, les cuisiniers préparaient des repas qu’ils déposaient sur des tables roulantes, avec du vin et de la bière. Thomas n’était pas fier de son aile sud ; la charité n’était pas loin, la différence lui semblait infime. La misère, la faim, l’ignorance lui paraissaient des questions qu’un homme seul, aussi riche fût-il, ne pouvait pas résoudre. Mais il s’était éloigné des combats – politiques et amoureux – de sa jeunesse, il vieillissait, et sa sensibilité ne le portait plus, il manquait de courage. Lors d’une promenade, il avait imaginé ce petit tour de passe-passe avec sa conscience, et l’avait mis en œuvre le lendemain. Il avait organisé les travaux d’aménagement, repensé les entrées et sorties, imaginé la disposition des lits, des tables, des salles de bain et fait installer une bibliothèque de livres de poche de plus de dix mille titres. Élisabeth de Sainte-Amande, qui était opposée à ce qu’elle appelait la nouvelle lubie de son mari, déserta, plus de cinq mois, le luxueux domicile conjugal pour une destination qu’elle tint secrète. La seule concession qu’elle obtint de son époux fut la séparation totale des deux parties de l’hôtel particulier, afin, hurlait-elle, que leur vie de couple fût préservée. L’aile sud. Il ne parlait jamais de l’aile sud. Il y faisait un tour, il y mangeait parfois, mais, en bref, ce n’était pas à mettre au compte de ses réussites. Quoi d’autre ?
Fuir, et se perdre, contre le temps, contre le piège du temps, perdre connaissance, se perdre au sud du sud, s’oublier soi-même, respirer d’autres souffles, se réveiller ailleurs mais vivant, se réveiller avec toi mon amour. Tender is our love, sweet are your lips, lonely I am. Fuir, marcher des heures, des jours sur des chemins de montagne, alone, alone, le vent cinglant nos visages, et l’air nous renversant, marcher, marcher, courir, dévaler des pentes rouges, écraser les bois morts, nuages de neiges évaporées sur les cimes, plaques de neige fondante qui ruissellent et forment, très loin, dans la vallée, des rivières et des torrents. S’y plonger, comme dans l’eau de la Seine, prête à me prendre, si maintenant je le décide. Ivres, mon amour. Ivresse qui craque et brûle entre tes mains, ivresse des cimes, qui, là, proches et à prendre, gémissent et mordent, hurleront tout à l’heure. Fuir, être stryge sous l’amoncellement des forêts ou dans les arbres sous les coups de bûcherons abrutis, se perdre avec toi dans la lumière alanguie du soleil et entre les nuages-dromadaires, mouvants, dinosaures de notre enfance, et leurs ombres glissant devant nous sur les montagnes, sur les chaînes de sapins fous. Fuir, fuir, fuir. Se fuir. Se perdre dans des odes mentales, composer de longues rimes de nos plaisirs incandescents, célébrer notre amour partout, tous les jours, se dire bonjour mon bel amour, célébrer notre amour par des messages incohérents, sur du papier, sur des nappes, sur des tables vernies, graver notre fuite, l’inscrire partout, la hurler, l’écrire sur des écrans. Fuir, mon amour, escape, a stream is our love, rêver de tous les pays de nos sommeils ensemble, de l’Espagne et de la Catalogne, au sud du sud, de sommets, de déserts, de plaines, d’océans, et de mers trop petites dans des barques à deux voiles. Fuir nos absences, et tous les jours où nous ne sommes pas ensemble, réussir nos ratages, reprendre, recommencer, rater encore, recommencer. Il ouvrit les yeux. La façade occidentale de Notre-Dame l’écrasait, au loin. Il tira une longue bouffée ; il ouvrit les yeux. Plus ouverts, plus vivants. Où suis-je ? Loin de toi. Où es-tu ? Loin de moi. My beautiful lost love. Façade orientale, façade occidentale. En direction de. Il accéléra son allure, son ventre grognait toujours. Il croisait encore des jeunes filles qui, pour lui, n’existaient plus. Eau verte, bleue. Et le courant, les clapotis et le vent, douce brise sur ses yeux ouverts, fermés, le sifflement d’un merle sur une branche, caché, invisible, rugissement, pépiement, mugissement, rumeur, surdité de la ville, moteurs et mécaniques. Quai des Grands-Augustins, sous le tablier crasseux du Pont Saint-Michel. En passant par ici : un coup d’œil sur les pavés, un autre, le courant l’emporterait peut-être, peut-être pas. C’est une sensation presque jubilatoire : se dire qu’à tout instant je peux disparaître, comme ça, en claquant des doigts, t’oublier mon amour, faire disparaître la Seine et tout ce qui m’entoure. Arrêt définitif. En finir avec. Ma réalité et par là même la réalité. Rien. Du vide parfait. Silence. Mort. À qui dis-tu bonjour, mon amour, qui regardes-tu, qui croises-tu ? Si je faisais la somme de mes échecs. Le nôtre, notre échec. Film de ma vie, orage, souvenirs éteints, larmes d’enfant. Ne nous disons plus adieu, mon amour, comme dans les mauvais films, sur un quai de gare, dans un hôtel borgne, dans un palace. Rendons-nous l’un à l’autre. Je t’aime. Je t’aime dans la lumière espacée de cet après-midi de juin. On ne sait jamais comment ça arrive. Le temps passe, et l’on croit toujours, comme des gamins, qu’il reste un espoir, que l’on finira bien par se retrouver. Toute une vie d’attente et de mensonges. Le temps passe, rien ne change, et l’on ne se retrouve pas. Pas de happy end. Vide parfait. Le film de ma vie ? Une histoire d’amour, un ratage, comme des milliers d’autres avant et après moi. Nous avons joué, mon amour, nous avons perdu. Soixante ans demain, et je suis mort. Rendez-vous clandestins, jeux de dupes. Les combats amoureux de ma jeunesse, oui. Combats politiques et amoureux. Sentimental, aigri par toutes ces années d’errances, à passer à côté, à se fuir, et au bout du compte à ne rien voir. Et je pleure sur de vulgaires chansons d’amour, seul, à l’abri des regards. Sentimental, incohérent, immature. Tout l’amour, que j’avais au fond du cœur, pour toi, Rina Ketty me faisait pleurer et Barbara Streisand, l’amour dont tu méprisais la loi. Mots vides, phrases creuses, qui me touchent encore, à mon âge. S’allongeant, fixant le plafond dans le noir. Alors qu’il eût été si facile d’être différent. Jouisseur, ludique, comme je l’étais à vingt ans.
Figure de cire déterminée de A à Z. Choisir, inventer, connaître, voilà ce à quoi il avait cru. Personnage, figure d’un amour qui s’évanouit dans le temps. Your own. Vingt, trente, quarante, cinquante, infini, éternité dérisoire. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Une autre bouffée, et la cendre du deuxième tiers se détacha, tache grise sur les pavés mornes. Les deux tours de Notre-Dame séchaient au soleil, un échafaudage et d’immenses bâches vertes recouvraient la partie centrale de la façade occidentale, frontispice caché pour cause de travaux. Nettoyage de printemps, madame. Des ouvriers, perchés là-haut, à côté de gargouilles, circulant, courbés, fumant des clopes, riant sur les arcs-boutants, grimaçant de leurs dents noires au-dessus du portail de Marie, redonnaient aux pierres un semblant de leur couleur d’origine. To live and die, to love and do. Quai de Montebello, rive gauche. Toi et moi, à New York, il y a si longtemps, sur les rives de l’Hudson. Vent glacial de février, et nous, qui pensions que ce serait possible, nous le pensions encore. Et j’en rêvais. Je te rêvais mère de mes enfants, maîtresse, amante, femme d’une vie, d’une douce et longue, longue vie. Suis-je Thomas dans le rêve de Mary, suis-je le papillon de tes rêves, rêves-tu encore de moi, Mary ? La chanson d’Hendrix que nous écoutions après avoir fait l’amour. En soixante-sept ou soixante-huit. And the wind cries Mary, oui, le vent te pleure, Mary, le vent te pleure. Ton nom et le nom de notre amour. To live and die, to love and do. Tender is our love, sweet are your lips, lonely I am. Your own. Et les noms, et les mots de cette époque : Révolution, Socialism Workers Party, Quatrième Internationale, toi et moi dans l’Histoire, fiévreux, acharnés, tout à notre amour, à nos luttes, aux réunions du parti. Love and be silent ? Non, répondions-nous, hurler, se battre, hurler, se battre, et faire l’amour des heures durant, partout, dans des lits, contre des portes, dans des cours intérieures, sur les pavés, sur la terre humide, dans des champs – ciels lourds, après-midi de mai, le vent griffait nos peaux nues et des gouttes de pluie déjà dans le dos et sur les jambes –. Faire l’amour, oui. Ils avaient fait l’amour partout, spontanément, dans des hôtels, sur des moquettes défraîchies, dans des salles de réunion, sur de petites tables qui basculaient, et ils étaient tombés ensemble, ils avaient ri, ils avaient été obscènes, et gamins. Ils avaient fait l’amour, ivres, à la pointe du jour, ou sans boire, vers midi, et à toutes les heures de la journée. Spontanés, oui, irresponsables, un relâchement rapide et continu, une détente de leurs corps enlacés, des joies enfantines d’adultes amoureux. Obscènes et enfantins, joueurs, et le paradoxe n’était qu’apparent. Elle lui glissait des mots obscènes au creux de l’oreille, elle gémissait, homme et femme, sans distinction, et elle l’empoignait si fort, et elle le mordait si violemment qu’il perdait connaissance, oubliait son histoire et leur pays, les lieux, les noms et les langues. Ils avaient fait l’amour sous des tentes de meetings, dans un coin, alors qu’à la tribune de sombres barbus à lunettes proclamaient la Révolution Permanente. Ils s’étaient blessés, ils s’étaient manqués, ils avaient disparu ensemble, ils s’étaient dissous, d’individus séparés saisissant une réalité provisoire, ils devenaient mouvement, mouvement de leurs deux corps, un processus. Et aujourd’hui, des années après, il savait à quel point il avait été heureux avec elle, à quel point, à cette époque-là de sa vie. Arrêtons. Face à la Seine, une lettre à la main. Des mots pour toi mon amour. Des mots vite tracés, maintenant. Nous revoir, fuir et se perdre, mon amour, recommencer, tout reprendre à zéro. Il avait conscience du ridicule de la situation, lui écrire et la revoir peut-être, trente ans après, ou presque, alors que depuis ils ne s’étaient plus donnés de nouvelles. Film de sa vie, film d’une vie ratée, à se fuir, à la fuir, elle. Il la suivait de loin. Moi, à Paris, mon amour, et toi, mouvante et abstraite. Que cesse le temps qui nous sépare. Sur la berge, une vieille femme chantait. Les chatoiements de l’eau verte – qui s’écoulait, inlassable, d’une source lointaine à une destination qu’il ne connaissait pas, l’océan peut-être, cet océan qui l’éloignait un peu plus d’elle – se reflétaient sur les verres légèrement fumés de ses lunettes. Il s’arrêta à une dizaine de mètres d’elle. C’était une solide grand-mère – qui, peut-être, n’avait pas d’enfants, mais elle lui évoquait ça, une grand-mère –. Ses cheveux gris – ramenés en chignon et piqués d’une marguerite – étaient soignés – longtemps peignés, lui semblait-il –, comme l’était son costume – un chemisier blanc et une longue jupe plissée, dont les fleurs mauves et bleues chantaient elles aussi au soleil, douce mélodie d’amitiés et de repas de familles, fleurs de carnaval, guillerettes et optimistes pour la scène –. Peut-être vivait-elle dehors, mais tout, dans les traits de son visage, dans la grâce qu’elle mettait à lancer – de sa voix grêle et aiguë – ses airs nostalgiques, dans sa présentation – l’ensemble relevé d’une paire d’escarpins dorés, imitant les trucs de spectacles et de revues, pointe de faux luxe dans un pauvre univers –, tout en elle respirait, quoi, le courage et l’envie d’être debout face à une foule de passants et de passantes qui ne s’arrêtaient pas, qui ne jetaient pas une oreille à ses efforts, comme si elle eût été invisible. Ses mains graciles s’agrippaient à un mauvais micro en plastique, relié par un fil à une boîte minuscule, caisse de résonance, qui atténuait sa voix, la lançait dans le vide, au gré du vent. Pourquoi à soixante ans décide-t-on de sortir de chez soi – si le chez-soi existe – et de s’en aller sur les pavés, devant d’impossibles individus – hommes, jeunes ou vieux, femmes, belles ou pas, adolescents, étudiants, promeneurs, ayant d’infinies préoccupations, d’autres désirs, un rendez-vous, peu importe – pour chanter avec trac des airs dont tout le monde se fout. Ne sentait-elle pas – cette pauvre vieille, cette vieille folle – qu’elle n’existait pour personne, et qu’elle gênait le déroulement de ces existences, son harmonie. Pourquoi chantait-elle ? À cause de lui, peut-être, pour cet homme qui s’était arrêté, pour l’observer, l’écouter, et se poser la question, et des hommes qui, comme lui, dans le temps, sous le crépitement des feuilles et leur doux balancement, sous le soleil – vertes, jaunes, mordorées, flamboyantes, lumineuses – avaient fumé un cigare, et des femmes, rentrant d’une escapade, et qui, un peu mélancoliques, écoutaient cette voix de grelot. La vieille tremblait en chantant, son autre main serrait les paroles qu’elle déchiffrait à mesure, ou faisait mine de déchiffrer. Et ses yeux allaient et venaient – des mots sur la feuille, protégés par une pochette translucide, aux gens qui passaient –. Et sa voix – si faible et fausse, si aiguë et en même temps si enthousiaste, si volontaire et amoureuse – lui donnait envie de pleurer. Souffrance, cruauté, misère humaine, vieillesse, tristesse. Les amours perdues, et l’eau s’écoulait encore, plus sale, plus lente, et ses scintillements l’affaiblissaient encore, et ses yeux se plissaient de plus en plus, ne se retrouvent plus, et les amants délaissés peuvent toujours chercher. Mais pourquoi ? Pourquoi cette vieille folle s’était plantée là et pourquoi chantait-elle justement cette chanson stupide ? Mes amours perdues hantent toujours mes nuits, et les Rois cachés là-haut, dans leur galerie, riaient en le voyant, et les deux tours de Notre-Dame, comme des bras ouverts se dissipaient, s’étiolaient à une vitesse vertigineuse. Il fouilla ses poches et en tira deux billets qu’il déposa en passant dans une corbeille en osier ; et la vieille chanteuse, transportée, n’aperçut même pas la somme qu’une silhouette fugitive venait de lui laisser. Souffrance, misère humaine, des milliers de vies monotones et solitaires, de gens seuls, de vies absurdes, d’esclavages quotidiens, d’impuissances, se multipliant l’un, l’autre, s’additionnant, se superposant, des milliers de dérives et de vies inutiles, mornes, sans raccourcis, d’infinies espérances, de rares moments de bonheur, grappillés ici et là, amours, amours perdus, vides et oubliés. Comme ces vieux qu’ils allaient, avec sa mère, visiter, des années auparavant, au milieu des années cinquante. Hospices de Brooklyn et du Bronx, charité chrétienne, conformisme de sa maman. Hospices, mouroirs organisés dans lesquels des vieilles et des vieux hurlaient et se chiaient dessus, prostrés dans leurs cages, les yeux dans le vide, pleurant lorsqu’ils leur parlaient ; et le long de couloirs qui puaient la maladie, la dégénérescence et la mort déjà, d’autres, débraillés et se grattant les couilles dans de mauvais pantalons, quémandaient une cigarette, comme s’il s’agissait de sauver leur peau. Sa mère passait de chambre en chambre, s’asseyait et discutait, et lui, gardait le souvenir de ces jours de visite. Jamais il n’oublierait ces cris, ces membres tordus, bleuis, rouges et cette vieille qui lui avait raconté les supplices qu’ils enduraient, tous, les infirmières sadiques et les repas qu’elle vomissait. Miss Brockett, qui l’avait embrassé sur la bouche, et qu’il était revenu voir plusieurs fois, jusqu’à ce qu’on lui annonce – une grosse blonde, un peu tarée et nymphomane – qu’elle avait changé de service. Qu’est-ce que ça voulait dire un service, puisqu’il l’avait cherchée partout et qu’il ne l’avait pas trouvée ? Des couloirs gris et blancs et verdâtres, interminables, des clameurs de désespoir, des rires de dingues, des visages marqués et ce type de quarante-cinq ans qui avait passé la moitié de sa vie dans des hôpitaux à se faire greffer des organes et poser des plaques en métal, sur tous les membres, tous les os, toutes les parties de son corps – mais avait-il encore un corps –, des vis, des bouts de ferraille, plantés à coups de marteau, et qui riait de ses propres blagues. Ses rires résonnaient encore, stridents et brutaux, rires de mouettes agonisantes, se posant sur l’une des fenêtres, cris d’oiseaux. Il devait avoir quinze, seize ans à l’époque, et il sortait à peine d’une enfance et d’une adolescence choyées par sa mère, une éducation artiste et pieuse – longues heures de prières et de sermons, chez lui ou dans des nefs, sur des bancs de bois dur –. Mais il savait que, bientôt, il ne croirait plus ; une ironie malveillante l’empêchait de pénétrer ces rengaines ; et les visites aux hospices entretenaient cet état d’esprit, le métamorphosant en une colère froide dont il contenait l’explosion. Pendant dix-huit ans, il serait l’enfant modèle, dont rêvait sa mère, Rose O’Brien."
Le Peintre, pages 92 à 110, Cyril Grosse,
édité par Les Cahiers de l'Égaré, en février 2002
Content de retrouver une ville plus propre, avec moins de déjections canines, moins de voitures, avec les vélib’ très utilisés et dont je me suis servi, préférant quand même remonter à pieds, de la place Monge à Stalingrad par la Bastille et le canal puis poursuivre jusqu’au parc Pajol ou à celui de La Villette, là où c’est populaire, où ça guinche,
pique-nique, glande, chite, joue de la musique, des percussions, joue au roller, au skate, au ballon de foot, de volley, de basket, content de retrouver quelques amis, content de visionner des films en DVD, américains bien sûr, comme À vif, avec Jody Foster ou L'assassinat de Jesse James, avec Brad Pitt, content de retrouver le foyer vietnamien où on mange pas cher...